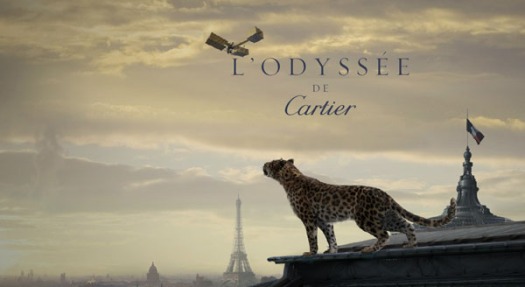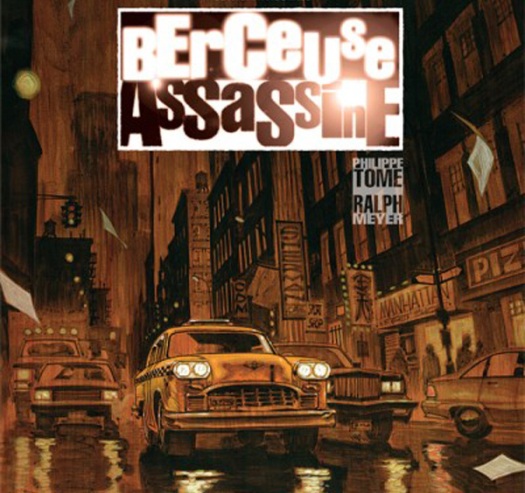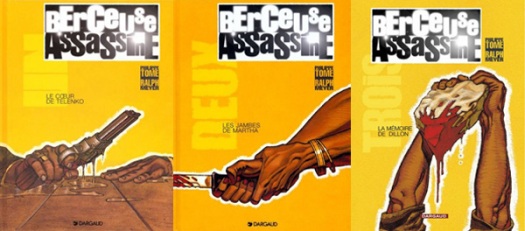Annonciation, Léonard de Vinci – 1475 (cliquer sur l’image pour l’agrandir)
Annonciation, Léonard de Vinci – 1475 (cliquer sur l’image pour l’agrandir)
A la fin du 15ème siècle, Léonard De Vinci, alors âgé d’une vingtaine d’années, travaille dans l’atelier de Verrocchio. Aux côtés du peintre, sculpteur et orfèvre qui comptait parmi les plus influents du Quattrocento, De Vinci apprend. Il alimente son « don » initial pour la peinture avec de nouvelles techniques, comme la perspective qu’a vu naître la Renaissance italienne.
Il suit également des cours auprès d’un théologien, qui lui transmet les fondamentaux de la religion chrétienne et lui permet ainsi de réaliser – ce qui est sans doute l’une de ses toutes premières oeuvres – cette Annonciation. Nous sommes en 1475.
L’Annonciation, telle qu’elle figure dans la Bible, est décrite par le moment où l’Ange Gabriel annonce à Marie qu’elle est enceinte, et qui plus est, qu’elle va enfanter le fils de Dieu.
Quatre siècle plus tard, à travers le tableau New York Movie d’Edward Hopper, on pourrait croire à une réinterprétation de l’Annonciation biblique. La composition, les techniques de perspectives ainsi que les thèmes suggérés par Hopper semblent se trouver dans le plus pur sillage florentin. Et si NY Movie pouvait être apprécié comme une Annonciation moderne ?
 New York Movie, Edward Hopper – 1939
New York Movie, Edward Hopper – 1939
Traits caractéristiques de l’Annonciation
Peindre une Annonciation revient à se conformer à un ensemble de « règles », de détails qui caractérisent le genre. Une Annonciation est donc un genre en soi, tout comme il existe un genre « Vierge à l’enfant » ou encore « Adoration des Mages ». Plusieurs attributs sont associés au thème de l’Annonciation, cher aux artistes florentins de la Renaissance italienne.
 Annonciation, Sandro Botticelli – 1485
Annonciation, Sandro Botticelli – 1485
Tout d’abord, dans une Annonciation, l’histoire est incarnée par deux personnages que sont l’Ange Gabriel et la Vierge Marie. Ces personnages sont systématiquement positionnés de la façon qui suit : l’Ange à gauche, Marie à droite. En respectant le sens de la lecture, de gauche à droite, le tableau fait état d’un dialogue dans lequel l’Ange s’adresse à Marie.
De plus, l’Ange est généralement « poussé », guidé, par un souffle (qui peut parfois être une lumière) divin. Cette énergie divine est matérialisée par quelques traits en diagonale, et semble se diriger vers Marie. Une direction comme imposée à l’oeil qui nous fait rentrer d’avantage dans le sujet du tableau, la grossesse de Marie.
Cette impression de mouvement est d’ailleurs renforcée par la perspective : le tableau représente un monde ordonné, mesurable et compréhensible par l’homme.
Un autre détail que l’on retrouve dans les Annonciations est le hortus conclusus – le jardin enclos. C’est un élément iconographique de l’art religieux européen souvent associé à la Vierge Marie, qui, comme une nouvelle Eve, pourrait rendre possible la rédemption. En tant qu’attribut de Marie, la végétation peut se matérialiser dans les Annonciation par un jardin mais aussi, souvent, à travers le lys blanc (comme celui que porte l’Ange dans le tableau de De Vinci). Ce lys renforce le symbole de pureté virginale, associé par essence à la Vierge Marie.
Dans une Annonciation, on trouve aussi des colonnes, qui ne sont finalement pas utilisées à des fins architecturales mais bien spirituelles. Elles sont en quelque sorte le lien entre ciel et terre, entre divin et mortel, et sont le signe de la présence de Dieu auprès des hommes (cf. les colonnes votives construites par les Romains pour prier les Dieux). Ces colonnes sont généralement au coeur des Annonciations (et littéralement au centre du tableau) dans la mesure où elles matérialisent le mystère de l’incarnation – et plus symboliquement encore, une idée de « pénétration » du divin dans le monde mortel.
L’Annonciation dans New York Movie
La composition de New York Movie n’est donc pas sans rappeler celle d’une Annonciation. En effet, on y retrouve deux types de personnages – les spectateurs dans la salle de cinéma et l’ouvreuse – une colonne, des perspectives, de la lumière. Egalement, chaque personnage occupe un espace qui lui est propre.
Le premier élément de rupture avec l’Annonciation « classique » vient du fait qu’il n’y a pas de dialogue. Les spectateurs, d’un côté, sont face à la toile tandis que l’ouvreuse est seule dans le couloir. Sa position est celle d’une personne en méditation, introvertie (versus Marie qui écoute, reçoit et accepte l’annonce de l’Ange). Ici, il n’y a pas d’échange ni de communication possible entre les personnages.
Cette idée est renforcée par la colonne massive qui occupe le centre du tableau et coupe littéralement la scène en deux. Une colonne qui, bien qu’ornée de végétaux pourrait évoquer le jardin et les fleurs, nous indique qu’elle est une frontière, une séparation entre deux espaces, entre deux mondes. Et ces deux mondes semblent repliés sur eux-mêmes : l’ouvreuse est dans une position d’introversion, pensive alors que les spectateurs lui tournent le dos, les yeux rivés sur l’écran de cinéma (qui est soit dit en passant LE sujet du tableau, New York Movie). Pour le coup, la diagonale mise en scène par Hopper dans ce tableau rompt complètement avec la dynamique divine des peintres italiens. Elle n’est pas là pour amener le sujet et attirer notre attention mais bien pour écarter notre regard. Le point de chute de toutes ces lignes diagonales se trouve en bas de l’écran et ne nous apprend rien – il contribue à nous éloigner un peu plus du personnage de l’ouvreuse, qui est pourtant dans la lumière.
Alors, que signifie cette mise en scène ? Hopper s’approprie-t-il les codes de l’Annonciation pour finalement mieux les détourner ? Cette ouvreuse, qui semble d’ailleurs se tenir le ventre, peut-elle être une interprétation contemporaine de Marie ?
Comme ses prédécesseurs florentins, Hopper est un maître de la perspective, et il use de cet art dans un grand nombre de ses tableaux (notamment dans Chair Car, en 1965). Sauf que SA perspective est que l’Annonciation moderne n’est pas aussi positive et porteuse d’espoir que dans la Bible.
En éloignant notre attention du seul personnage éclairé, Hopper dresse le portrait d’une femme d’autant plus mélancolique, comme abandonnée, et paradoxalement, cela ne fait que raviver l’intérêt (ou peut-être la compassion) que nous pouvons porter au personnage. La salle étant plongée dans l’obscurité, c’est bien elle que l’on voit et que l’on observe. C’est bien elle, qui, toute vêtue de bleu permet au rouge et au jaune de fonctionner et de former le trio primaire. Elle semble ainsi garante d’un équilibre, d’un ensemble qui la dépasse et dont les raisons lui échappent totalement.
La lumière divine des Annonciations semble laisser la place à un éclairage plus cru et factice ; une lumière qui paradoxalement assombrit ce qu’elle éclaire. C’est peut-être une Annonciation moderne, en négatif des Annonciations classiques que cherche à (dé)peindre Hopper à travers ce désenchantement. A la fin des années 1930, l’entrée en guerre laisse place à un pessimisme affiché et qui semble inaltérable, et la promesse du Messie, de l’espoir, n’exprime chez Hopper que la solitude et le caractère mortel de la condition humaine.
Par ces compositions, Hopper déstabilise le spectateur qui ne sait plus vraiment de quel côté il doit se positionner, car il semble finalement tenté de se placer à deux endroits à la fois. Le but est-il ne nous faire douter ? Ou bien précisément de nous faire prendre du recul ?
Des questions que le peintre laisse toutefois ouvertes et libres à l’interprétation de chacun, comme une porte de sortie. Et cet échappatoire nous le retrouvons au fond à droite du tableau avec ses escaliers dévoilés. Le rideau aurait pu être fermé. Or, Hopper nous laisse entrevoir une possibilité d’ascension et donc, avec elle, d’espoir. Cet espace en haut des escaliers, que l’on ne voit pas, détient peut-être la suite de l’histoire. Cet ultime détail fait également partie des Annonciations florentines : il y a toujours une ouverture sur « l’autre pièce », celle de tous les mystères, celle de la fécondation de l’esprit Saint et de la promesse d’incarnation.